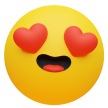De la motte castrale au donjon de pierre (Xe-XIe siècle)
A partir du Xe siècle et la féodalisation de la société, l’Europe se hérisse de nombreux lieux fortifiés ou châteaux. Symbole de pouvoir sur les hommes et sur la terre, le château évolue à la fin du Moyen Âge pour devenir de plus en plus un lieu de résidence seigneuriale, princière et royale.
La motte castrale
La motte castrale apparaît dès la seconde moitié du Xe siècle dans un climat d’insécurité et de rivalités permanentes, engendré par le morcellement du pouvoir. Cette structure, à la fois résidence seigneuriale et place forte, devient le symbole de la domination du maître des lieux. Elle est constituée d’une tour de bois carrée ou rectangulaire qui prend appui sur un monticule de terre artificiel. En contrebas est aménagée une cour — basse-cour ou bayle — généralement circulaire et entourée d’une palissade et d’un fossé. Elle abrite les logements des domestiques et des hommes d’armes, les écuries, la forge, des fours et des granges. Une rampe de bois sur piliers permet d’accéder à la tour car elle est séparée de la basse-cour par un fossé et deux autres palissades (au pied de la motte et autour du donjon). Cette tour sert le plus souvent de résidence au seigneur et à sa famille, et de réserve de nourriture. Le seigneur est en premier lieu un guerrier et un chef militaire car il doit affirmer et défendre son autorité sur ses terres. En cas d’attaque, la population locale trouve refuge dans la cour. La défense des lieux est assurée par la mise en place d’obstacles devant empêcher la progression de l’attaquant : les fossés, les talus, les palissades, la surélévation de la tour. Les assiégés utilisent des projectiles pour empêcher l’assaillant d’atteindre la palissade et d’y former une brèche. L’attaquant peut aussi tenter d’incendier les enceintes de bois.
Le donjon
Les premiers donjons en pierre apparaissent au croisement des Xe et XIe siècles. La pierre n’a pas directement succédé au bois : son usage dépendait des ressources régionales et des moyens du seigneur. Parallèlement, l’utilisation du bois s’est maintenue tardivement (au-delà du XIIIe siècle). Un des plus anciens donjons de pierre est celui de Langeais (fin du Xe siècle) dont la construction a été ordonnée par le comte Foulques Nerra, commanditaire de nombreux ouvrages de pierre en Anjou et en Touraine. Autre donjon remarquable, celui de Loches (Indre-et-Loire) construit aux alentours des années 1010-1035. La défense reste cependant passive : la porte est située en hauteur sur le flanc le moins exposé, les murs sont épais, les fenêtres rares et étroites. Les fossés et les palissades sont encore utilisés. Seules des galeries de bois placées en surplomb au dernier niveau du donjon — les hourds — permettent de lancer des projectiles ou d’utiliser des armes de tir.
Le château de pierre (XIIe-XIIIe siècle)
Les nouveaux châteaux de pierre suivent d’abord le plan traditionnel des châteaux à motte pour se complexifier au fur et à mesure des évolutions techniques et martiales.
Les châteaux « philippiens » du Moyen Âge
Le règne du roi Philippe Auguste (1180-1223) est marqué par le renforcement du pouvoir monarchique et l’agrandissement du domaine royal. En parallèle, l'architecture des châteaux évolue : on parle de château philippien. C’est le fruit de plusieurs années de luttes intenses face aux grands seigneurs mais aussi contre les Plantagenêts (les rois Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre) qui possèdent — en plus de l’Angleterre — l’Anjou, la Normandie et l’immense duché d’Aquitaine. Cette autorité se manifeste viala nouvelle titulature de Philippe Auguste à partir de 1204 : il n’est plus roi des Francs mais bien roi de France.
Elle s’exprime également à travers la construction ou l’amélioration de nombreux châteaux sur l’initiative royale. On parle de modèle « philippien » car les architectes de Philippe Auguste respectent globalement les mêmes principes de construction (formes, dimensions, organisation de la défense) qui seront par la suite largement imités ou repensés. Les châteaux philippiens suivent un plan ramassé rectangulaire ou polygonal car la surface à défendre est ainsi réduite. On multiplie également les tourelles pour ne laisser aucun angle mort (protection des angles et des flancs). Le donjon perd sa prédominance, devenant une tour plus imposante que les autres servant à défendre un point sensible (excepté au Louvre où il est positionné au centre). Dans l’enceinte du château, les bâtiments s’appuient le long de la courtine afin de dégager le centre de la cour : les manœuvres et les déplacements s’en trouvent simplifiés. Plus grands et confortables, une partie des logis de la cour sert d‘habitat et de salle d’apparat (de plus en plus rarement situés dans le donjon). Parmi les nombreux châteaux philippiens, le Louvre reste le modèle absolu en la matière. On peut également citer Dourdan (Essonne) qui demeure le représentant le plus élaboré et le mieux conservé du modèle philippien.
Château-Gaillard, la forteresse
Dans sa lutte contre le roi de France Philippe Auguste, le roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion fait construire Château-Gaillard en Normandie (1197-1198), qui est à la fois classique et innovant. La pièce maîtresse reste toujours le donjon, mais il est cylindrique et renforcé par un éperon et des contreforts. Le plan du château est complexe au vu de la succession des éléments défensifs : deux enceintes, plusieurs fossés et un ouvrage de fortification avancé qui protège le flan le plus vulnérable et sert d’entrée au château. Perché au sommet d’un éperon rocheux, la position stratégique du château permet de contrôler et de verrouiller tout un pan de la Seine en amont de Rouen. Dans le Sud, on tire également avantage des reliefs naturels : le château de Montségur (Ariège) occupe un sommet montagneux et les quatre châteaux de Lastours (Aude) sont construits sur un éperon rocheux.
Des fortifications renforcées
Certains châteaux au Moyen-Âge voient également leur défense entièrement repensée et améliorée. Quand il s’agit de conquêtes, la symbolique est d’autant plus forte. Après la prise de Chinon (Indre-et-Loire) en 1205, Philippe Auguste fait renforcer le système de défense (en ajoutant notamment deux tours). Même chose à Gisors (Eure) où deux nouvelles tours sont construites et à Falaise (Calvados) avec l’ajout d’une tour et la transformation de l’enceinte.
Les techniques de combat et de siège se sont considérablement améliorées : les châteaux et leurs fortifications doivent s’adapter en conséquence. Face aux machines de jet (trébuchets et mangonneaux) les murs, plus épais et plus hauts, sont talutés : leur base est renforcée par un appareil de pierre incliné. Les tours se multiplient et sont reliées entre-elles par un mur appelé courtine, lui-même surmonté d’un chemin de ronde le plus souvent crénelé. La partie pleine du créneau servant à s’abriter se nomme le merlon. Pour les tours, on adopte progressivement une forme cylindrique : elles sont plus résistantes et nécessitent moins de matériaux. Elles offrent une meilleure visibilité pour les tireurs et moins de prises face aux tirs adverses. Les hourds existent toujours mais ils peuvent être incendiés : le mâchicoulis, balcon de pierre percé, se montre plus résistant. À la fin du XIIe siècle, des archères sont percées dans les murs de pierre pour permettre de tirer et d’observer l’ennemi tout en restant protégé. La barbacane, fortification de pierre généralement semi-circulaire, barre l’accès principal au château puisqu’elle est placée en avant de la porte. Le château est isolé par un fossé désormais plus large et plus profond, parfois rempli d’eau. Un pont de bois amovible, ou pont-levis, permet de franchir les douves.
Evolutions des châteaux de pierre (XIIIe-XVe siècle)
L’évolution des châteaux de pierre au cours des XIIe et XIIIe siècles montre que la défense passive est abandonnée au profit d’une défense active.
Une défense active
Cette défense ne s’organise plus en profondeur selon une succession d’obstacles mais de façon linéaire. Le roi de France Philippe Auguste fait élever au cours de son règne (de 1180 à 1223) de nombreuses fortifications, selon un plan qui deviendra un modèle pour les autres seigneurs et souverains. Il peut s’agir de constructions nouvelles (châteaux du Louvre, de Rouen ou de Dourdan) ou d’améliorations (Chinon, Gisors). Malgré l’affermissement du pouvoir royal face à celui des féodaux en France, certains grands seigneurs n’hésitent pas à s’affirmer au travers de nouvelles constructions. L’exemple le plus spectaculaire reste le château de Coucy (première moitié du XIIIe siècle), l’un des plus massifs qui ait été érigé en France : le donjon à lui seul mesurait 55 mètres de haut avec des murs de sept mètres d’épaisseur !
Les châteaux forts continuent d’évoluer durant les XIVe et XVe siècles : face aux troubles engendrés par la guerre de Cent Ans (1337-1475) et l’épidémie de peste de 1348 (pillages, révoltes paysannes), ils démontrent une nouvelle fois leur efficacité. Le pouvoir royal favorise donc la construction de nouveaux châteaux (Vincennes, forteresse de la Bastille), l’amélioration de ceux déjà existants et l’abandon voire la destruction d’autres jugés inutiles ou trop faibles.
L’évolution de l’artillerie
L’apparition des canons au milieu du XIVe siècle ne modifie guère la donne dans un premier temps, car ils sont encore rares et leurs boulets de pierre sont peu efficaces. Progressivement, les châteaux s’adaptent pour accueillir eux-mêmes leurs propres canons : agrandissement des meurtrières, percement de canonnières et aménagement de terrasses pour y installer les machines. L’utilisation de boulets métalliques dès la seconde moitié du XVe siècle amorce le déclin des châteaux forts qui ne survivront pas au Moyen Âge. L’évolution de l’artillerie n’est pas la seule cause de leur disparition : c’est aussi le résultat de profondes mutations politiques et sociales. Quand ils le peuvent, les seigneurs réaménagent leurs châteaux. Le confort et l’apparat sont privilégiés, les éléments médiévaux (tours, fossés) devenant purement décoratifs. La forteresse conserve quant à elle un rôle important : elle connaîtra un renouveau majeur au XVIIe siècle grâce à Vauban.