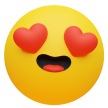C'est surtout le grec qui est visé par ce collège de théologiens, fondé en 1253. Il regroupe tous les collèges parisiens situés sur la rive gauche au sein de l'Université de Paris et assure la formation des clercs, c'est-à-dire les cadres et agents administratifs des institutions royales.
Rabelais a utilisé, comme pseudonyme, un anagramme de François Rabelais. C'est-à-dire qu'il reprend toutes les lettres de ses nom et prénom. Une manière d'indiquer qu'il s'agit bien de lui, mais qu'il ne répond pas aux conventions qu'on lui impose. Ce procédé sera repris par Voltaire.
Rabelais critique les théologiens de la Sorbonne qu'il nomme maîtres sophistes, pour privilégier les figures de style, donc les constructions de langage. Il critique ainsi une éducation formaliste, qui est fondée sur un apprentissage mécanique excluant tout raisonnement propre.
Le moyen français devient la langue officielle du royaume de France avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Le développement de la littérature en moyen français apporte constructions grammaticales et vocabulaire qui s'epanouiront dans le français classique.
Dans le moyen français les déclinaisons, présentes dans le latin, disparaissent. Mais il reste très marqué par ses origines latines et le sujet est bien souvent contenu dans la forme conjuguée. Des lettres encore présentes, dans le moyen français, seront éliminées dans le français moderne.
Rabelais ridiculise les personnages des maitres sophistes en leur donnant des noms aussi ridicules dans la prononciation qu'évocateurs dans les cultures grecque et biblique, comme Thubal Holoferne. Il décrit aussi des méthodes d'apprentissages désuètes comme l'écriture en gothique.
Le choix de personnages tels que Gargantua, Grandgousier ou Gargamelle, qui sont des géants, vise à accentuer le caractère ridicule que constitue l'apprentissage par les sophistes aux yeux de Rabelais. Celui-ci y voit un enseignement formel reposant sur la quantité de savoir, au détriment du fond.
Contrairement à la parabole, qui raconte une courte histoire avec des événements du quotidien, l'hyperbole consiste à créer une exagération, de manière à exprimer un sentiment extrême et frapper les esprits. L'élément comique réside dans les portraits ridicules qu'il dresse de ses personnages.
Rabelais créa de nombreux mots comme les adjectifs « célèbre », « frugal », « patriotique » et « bénéfique », ou encore les noms « génie », « automate », « indigène »... Il est aussi à l'origine de nombreuses expressions, dont « la substantifique moelle » ou encore « les moutons de Panurge ».
Le nom d'Eudémon signifie « esprit bienveillant ». Il représente une incarnation de la culture, de l'esprit et du bon goût, face à l'enseignement des sophistes. Le contraste entre ce personnage, fin et bienveillant, et Gargantua éduqué par les sophistes, est à lui seul un effet littéraire.
10
Félicitations pour le score parfait !Encore un petit effort !
Retente ta chance, tu peux faire mieux.
Pour suivre tes progrès, crée ton compte Lumni, c’est gratuit !
Je crée mon compte
Aimé à 100% par nos utilisateurs

Joue à ce quiz et gagne facilement jusqu'à
 80 Lumniz
en te connectant !
80 Lumniz
en te connectant !
Il n’y a pas de Lumniz à gagner car tu as déjà vu ce contenu. Ne t’inquiète pas, il y a plein d’autres vidéos, jeux, quiz ou articles intéressants à explorer et toujours plus de Lumniz à remporter.
François Rabelais
François Rabelais est un écrivain de la Renaissance, né en Touraine, en 1483. Ecclésiastique et médecin, il manie la parodie et la satire, lutte pour la tolérance et le retour au savoir de l'Antiquité grecque et romaine, dont la diffusion est rendue possible par le développement de l’imprimerie. Il s'en prend aux abus des princes et des hommes d'Église, auxquels il oppose la pensée humaniste évangélique. Mais il introduit aussi, dans la littérature, la culture populaire, paillarde et « rigolarde », marquée par le goût du vin et des jeux.